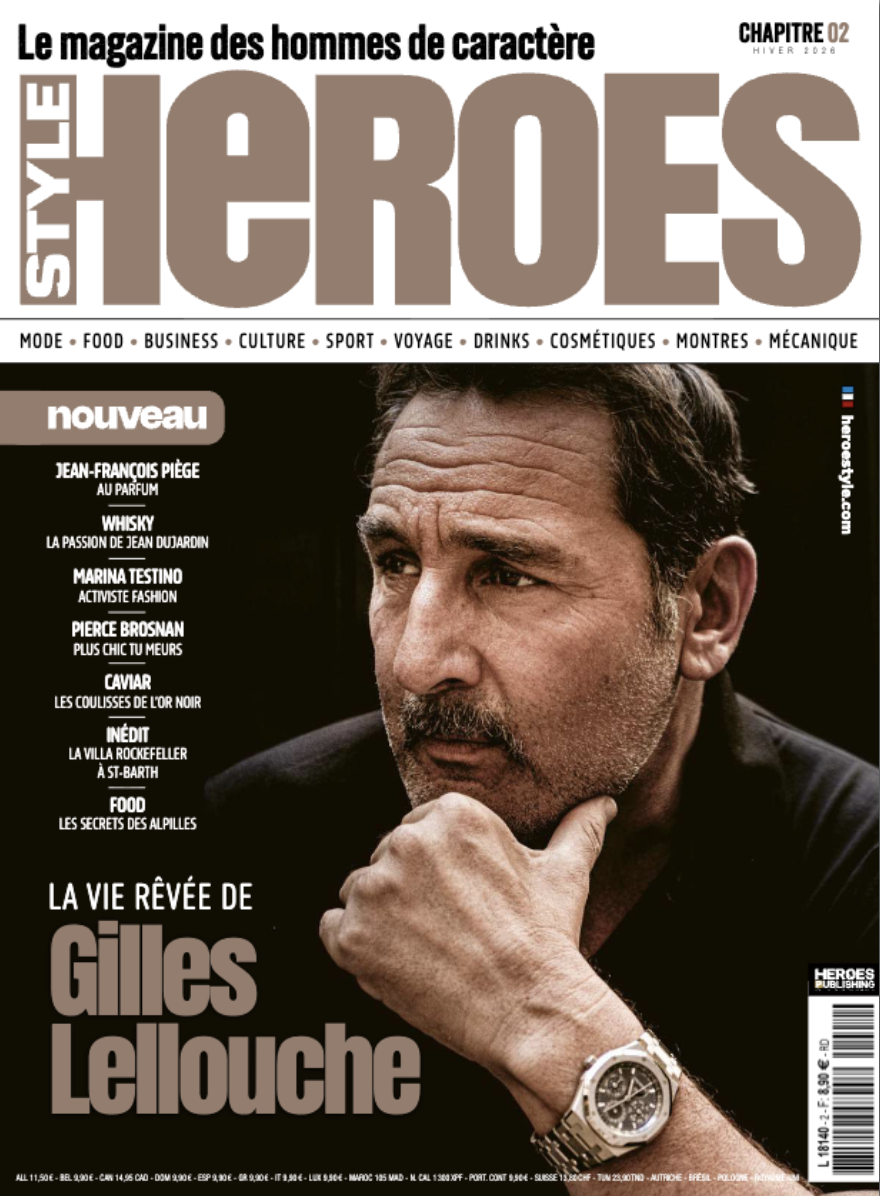Genèse d'un chef-d'œuvre
Symbole d'innovation et de style, la Citroën DS n’est pas née d’un simple coup de crayon. Retour sur deux décennies de recherches, d’audace et de remises en question. Par Serge Bellu.

La création de la Citroën DS résulte de plus de vingt ans de recherches et d'ajustements, mêlant innovation stylistique et contraintes techniques dans un contexte d'après-guerre.
Quand on leur demande quelle voiture ils auraient aimé dessiner, la plupart des designers citent la DS. Elle reste une référence absolue dans l'histoire de l'automobile, un accident sublime. Pourtant, pour parvenir à cette forme inoubliable, les stylistes ont passé de longues heures de recherches et de remises en question.
Un trait de génie. Juste une flèche. Une lame acérée. La simplicité ultime. La pureté absolue. Il semblerait que le profil de la DS soit né d’un seul coup de crayon. Il n’en est rien. Son développement a été laborieux et s’est étalé sur une vingtaine d’années. L’étude a commencé aussitôt après le lancement de la Traction sur le marché. Dès qu’il est arrivé aux commandes de l’usine Citroën, juste après la mort d’André Citroën, Pierre Michelin annonça des dispositions radicales pour redresser une situation financière qui était catastrophique.
La nouvelle direction voulait sortir de la stratégie du modèle unique que Citroën avait toujours défendue. Il échafauda un plan de développement incluant trois produits inédits : un véhicule minimaliste, le projet TPV (très petite voiture) qui aboutira à la 2CV ; un modèle populaire, le projet AX, qui concurrencerait les modestes 301 de Peugeot et Celtaquatre de Renault ; une routière qui s’inscrirait dans la suite logique de la Traction, le projet VGD (voiture de grande dimension). Flaminio Bertoni, qui avait créé la ligne de la Traction Avant, fut chargé de plancher sur les produits du futur.
Dans un premier temps, il songea à actualiser la ligne de la Traction Avant. Les premiers dessins montrent une simple évolution de cette dernière, conservant sa structure, mais adoptant des volumes plus arrondis satisfaisant à la vogue aérodynamique du moment. Les propositions suivantes s’en éloignèrent et s’orientèrent à partir de 1936 vers une voiture inédite. Dorénavant, aucune pièce de carrosserie n’était reprise de la Traction, la surface vitrée était plus généreuse avec des montants affinés, la ligne de ceinture formait un arc de cercle et l’aile avant, éludée, était fondue dans la surface des flancs.

Flaminio Bertoni : l’artiste derrière le design révolutionnaire de la DS
Une note de Pierre Boulanger, datée de juin 1939, précise la définition de la VGD, mais la guerre suspend tous les travaux. Même si sur le plan de la mécanique rien n'est arrêté, on envisage d'emblée de créer une nouvelle génération de moteurs six cylindres à plat. À cet effet, Citroën débauche l'ingénieur Walter Becchia qui avait fait les beaux jours de Talbot-Lago. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la question du style repose sur un dilemme pour tous les constructeurs européens, car ils sont tiraillés entre deux sources d'inspiration, deux tendances, deux tentations : d'un côté l'influence du “streamline” importé des États-Unis, de l'autre l'esprit nouveau soufflant d'Italie.
Il n'est plus question de conserver les attitudes rigides d'autrefois, comme celles de la Traction Avant qui reprend du service en 1946 avec une ligne qui paraît alors bien démodée. Car désormais, les volumes souples et les formes enveloppantes sont de rigueur. Le projet VGD va par conséquent devoir adopter des courbes plus gracieuses. S'émancipant des mouvances principales de l'époque, Flaminio Bertoni suit sa propre voie, sa propre inspiration. Un croquis daté d'avril 1945 dépeint une silhouette fluide avec les ailes avant joliment intégrées dans les flancs, les roues arrière carénées et le pare-brise incurvé prolongé par des vitres d'angle qui offrent une visibilité dans l'esprit des Vutotal de Labourdette. Ces dessins présentent une pureté que n'avaient pas les propositions précédentes.
En juin 1945, un plan coté donne plus de précisions sur les dimensions : 439 cm en longueur et 300 cm en empattement. Plusieurs maquettes à l'échelle 1/1 sont réalisées à partir de ces dessins. En même temps, Pierre Boulanger envisage deux motorisations, VGD 125 et VGD 135, le nombre indiquant la vitesse maximale qui a été fixée. Mais Flaminio Bertoni revoit sa copie. Trop classique, trop convenue. L'iconoclaste décide d'explorer des voies moins attendues. Au cours des premières années suivant la Libération, la voie du monocorps est sérieusement envisagée par Flaminio Bertoni sous sa forme la plus engagée, avec le poste de conduite fortement avancé. Plusieurs dessins sont réalisés, mais de l'avis général, la formule que l'on ne nomme pas encore “monospace” s'avère trop radicale pour un public souvent conservateur. Exit la voie du monocorps ! Le projet VGD est désormais identifié sous la référence P1134.

L'évolution du projet VGD vers la DS : entre audace et compromis
Bertoni s'emploie à édulcorer son dessin, à s'éloigner du concept monocorps le plus radical. Moyennant quoi les formes s'empâtent, un petit capot s'esquisse, le poste de conduite recule, la partie arrière se compacte, l'avant s'alourdit d'une calandre encombrante. Au bout du compte, la voiture deviendra “éléphantesque” pour reprendre le qualificatif qu'on lui attribue au sein du bureau d'études. Susceptible, Bertoni est furieux de renoncer à une solution révolutionnaire et le projet référencé P1134 prend une toute autre tournure en 1950. De nombreux dessins sont réalisés ainsi que de multiples maquettes qu'il est difficile de situer dans le temps avec précision, car aucun document retrouvé dans les archives n'est daté.
La ligne s'affine, le volume s'abaisse, le pavillon s'aplatit, la surface vitrée s'agrandit. Quand la face avant de la future DS commence à se dessiner précisément, l'arrière continue à se chercher. La surface vitrée hésite encore entre quatre ou six glaces latérales, entre lunette arrière panoramique ou pas. Ce n'est que quelques mois avant le gel du style que le traitement original de la lunette arrière est figé, avec sa visière et les clignotants coniques qui viennent se loger au-dessus du panneau de custode. Au cours de cette même année 1954, un autre thème est exploré sans déboucher sur un résultat concret sous la référence P1204 ou Projet S : il concerne une étude de berline aérodynamique.
De nombreux dessins datés de décembre 1954 montrent une silhouette allongée dont la partie arrière est prolongée par une longue pointe effilée se terminant par une dérive plantée verticalement comme un gouvernail. La surface vitrée est généreuse avec l'adoption d'un pare-brise panoramique, la suppression du pilier central et l'adoption d'un simple montant au niveau du panneau de custode. Étant donné la période où ces croquis sont produits, il ne s'agit plus de projets pour la DS 19 dont le style a d'ores et déjà été gelé. Sans doute la direction de Citroën avait-elle envisagé d'élaborer une grande routière plus sportive que ne le sera la DS. Susceptible, Bertoni est furieux de renoncer à une solution révolutionnaire et le projet prend une toute autre tournure.

Mentionnés dans cet article
OU